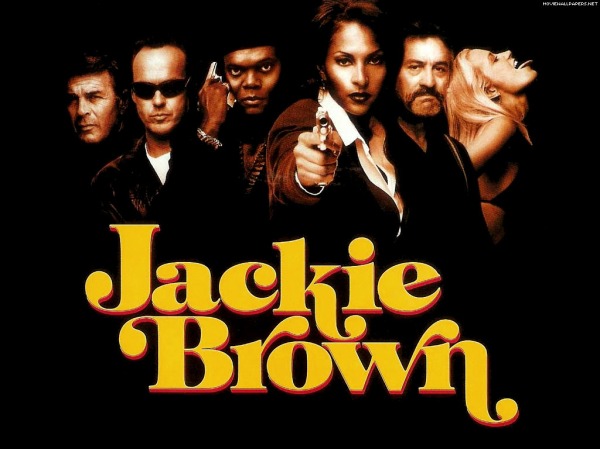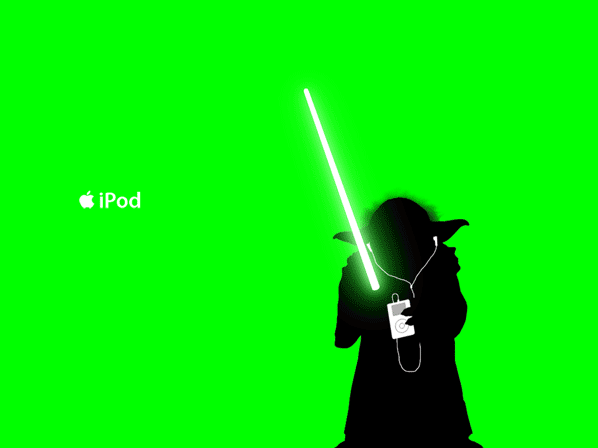de Gus Van Sant,
2013,
avec Matt Damon, Frances McDormand, John Krasinski…
★★★☆☆
L’Amérique oubliée
Chaque film de Gus Van Sant est un évènement (Will Hunting, Elephant…), bien souvent adulé par la critique et accompagné de récompenses (Palme d’or à Cannes en 2003 pour Elephant). Promised Land s’inscrit dans la lignée de Harvey Milk, un film qui marqua la carrière du réalisateur. En effet, depuis 2008, date de sortie d’Harvey Milk, le cinéaste a rompu avec son style un peu trash (Psycho ou Elephant par exemple) et s’est tourné vers des genres plus accessibles au grand public, comme le biopic ou la comédie dramatique. Promised Land pourrait quant à lui être catégorisé en tant que documentaire dramatique américain et écologique à visée militante – enfin sur le papier. Car, et c’est là le talent de Gus Van Sant, il parvient à faire d’un film, assez quelconque à première vue, un long-métrage stylisé, se démarquant de la traditionnelle comédie dramatique américaine.
On suit ici le personnage de Steeve (M. Damon), un représentant de Global, une compagnie énergétique multimilliardaire. Steeve, accompagné de Sue (F. McDormand), se rend dans une petite ville de campagne américaine afin d’en exploiter les ressources de gaz de schiste. L’investissement semble profiter à tous : la ville pourrait retrouver son dynamisme d’antan, les paysans devraient devenir aussi riches que les citadins et la compagnie, bien évidemment, trouverait elle aussi son compte, grâce à la revente du gaz de schiste. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Un vieil homme, respectable et respecté, critique publiquement la méthode d’exploitation, affectant, entre autres, l’environnement et les êtres vivants. De nombreux habitants le suivent et, dans un élan populaire, se mettent à contrarier le projet. Les choses se compliquent lorsqu’un militant écologiste débarque en ville et commence à étaler des preuves irréfutables concernant les risques d’une telle exploitation…
On est ici bien loin du scénario dramatique et grave d’Elephant. Ce long métrage de Gus Van Sant, qui n’est d’ailleurs pas vraiment le sien mais plutôt celui de Matt Damon, contraste réellement avec la filmographie du cinéaste. Promised Land a tout du drame hollywoodien des années 2000’s : un héros sympathique, attachant et rebelle, de méchants industriels et une vilaine associée, une histoire d’amour partagée entre drague, jalousie et rivalités et enfin une fin américaine (tout le monde est finalement heureux dans le meilleur des mondes). De plus, Promised Land semble ouvertement écologiste, un mouvement en constante extension aux Etats-Unis. Matt Damon et Gus Van Sant sont d’ailleurs deux fervents partisans de l’écologisme, ce qui rajoute une dimension militante (tournure en générale ridicule dans le cinéma hollywoodien) – sur le papier, encore une fois.
Car ce que Gus Van Sant nous propose, dans Promised Land, diffère, par son style, le point de vue qu’il adopte, de la comédie dramatique hollywodienne. Premièrement, chose rare, on se place du côté des méchants, alors que d’habitude, le cinéma américain se place du côté des victimes. D’autre part, notre héros, Steeve, est plus perdu qu’autre chose. Sa rébellion contre le système, ou plutôt l’industrie, n’est qu’apparente, le personnage de Matt Damon étant plus dans l’ignorance qu’autre chose. Un peu trop niais – certains préféreront le terme idéaliste – Steeve croit vraiment que Global, une entreprise multimilliardaire ne visant que le profit, veut venir en aide aux populations rurales. Par ailleurs, ajoutez que Promised Land, en plus d’adopter un point de vue original, révèle une face sombre, cachée des Etats-Unis : la crise dans l’Amérique rurale. Gus Van Sant utilise le prétexte du gaz de schiste pour aborder un problème bien plus grave, celui de la misère de l’Amérique profonde. Désindustrialisation massive, isolement, déconnection du système vis-à-vis des transports et des réseaux, pauvreté matérielle et culturelle… Le cinéaste filme un monde perdu, une société renfermée sur elle-même et volontairement exclue de l’économie. La population, par la désindustrialisation mais aussi par leur immobilisme, s’est empêtrée dans cercle vicieux qu’ils ne contrôlent pas (on se rend vite compte que c’est Global, c’est-à-dire l’argent, qui tire les ficelles dans la région, et ailleurs). Gus Van Sant décrit donc, avec Promised Land, la détresse de l’Amérique rurale, laissée à l’abandon dans une misère matérielle et culturelle.
Promised Land, et son double engagement, écologique et social, séduira facilement les spectateurs, grâce au constat, attristant et alarmant, qu’il livre. Stylisé par un cinéaste de talent, le film est agréable à regarder même si on aurait pu attendre un peu plus de la part d’un Gus Van Sant. On note quelques jolies trouvailles cinématographiques, comme la métaphore de l’eau dans l’évier, au tout début et à la fin du long-métrage. La prestation des comédiens est correcte mais aucune ne parvient à se faire remarquer. Cependant tous ces petits défauts énoncés à la suite peuvent être justifiés par l’aspect réaliste du film, proche du documentaire par moments. Par contre, on ne peut que blâmer Gus Van Sant pour sa happy-end à l’américaine, une fin tout simplement insupportable par sa niaiserie et son irréalisme. Dommage, car arrêter Promised Land au dernier retournement de situation aurait largement suffi, et fait de ce long-métrage un film remarquable.